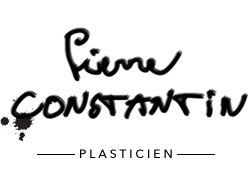Du geste au silence
Pia Malaussène
Classer un peintre dans un genre est une obsession académique. Pourtant, cela peut permettre de commencer à parler d’une œuvre.
Je pose donc que le travail de Pierre Constantin relève de la peinture gestuelle.
Cela libère d’avoir à la décrire, pour dire où et comment elle s’inscrit, soit dégager la façon dont le peintre se rapporte à son support. Et là, le sujet de la peinture n’est pas la chose peinte.
Bien sûr, Pierre Constantin peint des corps qui dansent et en figure le mouvement. Et lorsqu’il s’essaie à improviser sur une musique, on trouve dans le fil de son trait des ressemblances avec une portée de notes ou l’évocation d’une réalité sensible.
L’œuvre pourtant n’est pas dans son achèvement mais dans son accomplissement. Car la production finale ne trouve à exister qu’à travers le spectacle d’un geste posant sur le papier vierge des lignes parties d’on ne sait où et qui n’arriveront pas où l’on pourrait les attendre, se surchargeant les unes les autres ou déliant d’un trait le nœud où elles étaient retenues : « Ho ! une vache ! » dit l’enfant attentive. « Ha, il vient de la rayer… ». L’enfant voit quelque chose qu’on peut reconnaître une fois signalé mais ce n’est pas ce que l’on voit qui fait la vérité du dessin de Pierre Constantin, c’est ce qui en apparaît et devient : aucun trait ne précise la représentation et ne l’approfondit, c’est une histoire qui se trame, se développe, enchevêtre ses éléments dans le temps d’un récit non prémédité.
Le spectacle se donne pour une improvisation mais la notion de non-préméditation est plus intéressante. Elle rappelle que l’agent est bien là, dans l’innocence du surgissement de son acte mais non sans en être l’intime sujet.
Le geste ici n’accompagne pas la musique de l’instrument ou le mouvement du danseur pas plus qu’il n’illustre le concert ou la rencontre des corps. Pur tracé dynamique d’énergie vitale, le geste est celui d’un plasticien qui dessine.
Le plus fort de tout, sous couvert d’une collaboration, musicale par exemple, supposée ouvrir un champ d’inscription commune, c’est qu’il dessine : rien, c’est à dire quelque chose qui n’est pas là. Ou plus précisément, qui va ne pas être là.
Si l’on arrive à se libérer du vilain penchant à vouloir que tout soit image d’une chose, on se rend compte que le dessin de Pierre Constantin ne ressemble à rien. Il se sert d’une figure pour lui échapper, comme par de petits sauts l’acrobate sortirait du cadre et laisserait le vide comme événement.
On est proche de cette expérience enfantine qui consiste à lire la tête posée de côté sur le bras plié, à lire de biais pour apercevoir les cheminées blanches, les couloirs vides entre les mots, pour lire non pas en profondeur mais ce qui du fond se tend vers la surface matérielle.
On dirait que Pierre Constantin dessine en équilibre sur le monde dans une continuité jamais acquise, prête à se rompre à tout instant et pas seulement quand, se levant pour imprégner le calame, la main quitte la feuille. Le silence alors, puisque s’est tu le bruit du dessin en train de se faire, se ponctue d’une tâche ronde parfaite, laissée par l’encre goûtant du roseau taillé quand la main retourne à son geste.
Enluminure, le trait ceint un espace, le partage, l’indique, le forme comme le vase enferme une vacance aux mains du potier modelant le vide en travaillant la matière.
Le dessin organise l’espace pour délimiter les énoncés d’une représentation qui n’a jamais lieu tandis qu’on nous fait croire qu’elle est sur scène. Tromperie ? Trompe l’œil plutôt.
Le texte qui ne s’écrit pas, au cœur du dessin déroulant, reste à la charge de chacun, comme toute interprétation. C’est la mythologie du plasticien, gardée secrète. C’est la nôtre, libérée par distraction lorsque le lien de la musique et du dessin nous tient serrés au point de leur factice conjonction.
Du spectacle, à la fin, il ne reste rien de ce qui s’est passé. Ephémère, l’événement s’éteint dans le dessin devenu une signature, complexe, embrouillée, illisible : l’indéchiffrable du sujet.